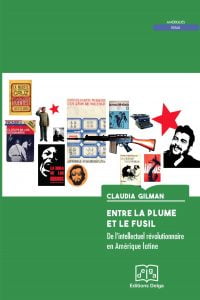Les éditions Delga viennent de publier Entre la plume et le fusil, un ouvrage de Claudia Gilman, qui retrace de manière exhaustive les débats dans le milieu intellectuel latino-américain, profondément marqués par la victoire des guérilleros cubains à la Sierra Maestra et l’apparition de la figure de l’intellectuel engagé. Dans cet extrait, Gilman poursuit son analyse sur le débat surgi dans le milieu intellectuel latino-américain autour des concepts d’avant-garde politique et artistique.
Lire la première partie de cet extrait
J’ai essayé de montrer comment la conjoncture politico-idéologique refusait cette promesse de bonheur (13). Avec l’abdication de l’espoir d’une esthétique de la rupture (qui permettait, d’ailleurs, de célébrer à nouveau un écrivain comme Rubén Darío), la renonciation à l’utilisation du mot « avant-garde » était associée à une signification précise de l’expression « avant-garde ». Ce dont on discutait au nom de la remise en question à l’avant-garde était la prétention, du côté des artistes, à l’autorégulation de leur propre production, indépendamment de quel type d’œuvres ils pouvaient produire. Non seulement l’avant-garde politique était la seule qui pouvait être considérée comme une avant-garde légitime, mais c’était idéologiquement une impertinence que les artistes ou les intellectuels pussent ou voulussent, même pour être unis par un même signifiant, être comparés à leur direction politique, pour laquelle ils n’étaient pas des égaux mais des subalternes. De cette façon, sans qu’il y ait eu un programme énoncé en termes proprement avant-gardistes, il y eut un moment paradoxal où le mot « avant-garde » ressortait, presque du néant, pour être contesté en termes idéologiques. On peut retrouver cette émergence, avec des connotations négatives, dans les paroles d’Ambrosio Fornet, qui, en 1968, à la conférence du Congrès culturel de La Havane, dont le titre était « L’intellectuel dans la révolution », avait prévenu : « Nous devons mettre à l’épreuve les formules qui arrivent avec l’étiquette d’avant-garde. » Fornet lui-même, un an plus tard et déjà avec l’accord d’un noyau dur d’intellectuels d’autorité révolutionnaire, déclara que jusqu’alors les intellectuels n’avaient été que « des vestales de la forme, des gardiens sous-développés de l’avant-garde ». (14)
La généralisation du l’anti-intellectualisme remit en question l’agenda culturel (d’ailleurs déjà réalisée) et non seulement l’expérimentalisme ou l’impulsion vers le nouveau. On attaqua in toto la nouvelle littérature latino-américaine. Il était naturel que l’émergence d’un discours théorique importé de France et mis en circulation par une partie de la critique et des auteurs, un discours qui de façon très sommaire affirmait qu’en littérature la seule chose importante était le langage, et était, dans ce contexte, particulièrement irritant pour la fraction « révolutionnaire » du champ intellectuel. L’idée d’une équivalence entre la modernisation esthétique et l’engagement idéologique devint également problématique, comme le démontraient les trajectoires de Sarduy, Cabrera Infante et, bien plus tard, Vargas Llosa et Carlos Fuentes, qui, à la différence du groupe anti-intellectuel, pouvaient invoquer le fantôme de Borges et voir en lui un précurseur.
Particulièrement gênante fut l’intervention de Carlos Fuentes qui introduisit une discussion en provenance d’Europe, dans laquelle une partie de la critique s’interrogeait (encore une fois dans l’histoire) sur le fait de savoir si le genre était ou non sur le point de mourir. La discussion européenne sur le roman commença à la fin des années 1950 et s’étendit pendant une certaine période : parmi d’autres exemples on trouve les textes de Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet et le Groupe 63, consacrée au roman expérimental en Italie ; à plusieurs occasions on rédigea des certificats de décès. En effet, Léon Tolstoi avait noté dans son journal, en 1893: « Le roman non seulement est éternel, mais il est déjà en train de passer. »
Dans son livre, Fuentes affirmait :
« Ce qui est mort ce n’est pas le roman, mais précisément la forme bourgeoise du roman et son terme de référence, le réalisme. (…) Plusieurs grands romanciers ont démontré que la mort du réalisme bourgeois annonce seulement l’avènement d’une réalité littéraire beaucoup plus puissante. » (15)
Qu’y avait-il d’irritant dans l’essai de Fuentes ? Sans doute, l’idée que le roman était « mythe, langage et structure » et l’idée que les grands romanciers qui pouvaient aspirer à la construction d’une littérature « plus puissante » exigeaient une « diversité d’explorations verbales » caractérisant précisément les écrivains latino-américains consacrés (certainement, pas seulement eux), y compris lui-même (16). La mention de Jorge Luis Borges en tant que fondateur de la modernité littéraire dans le continent, qui suscita une réponse colérique de Fernández Retamar (« Borges est le typique écrivain colonial, représentant chez nous d’une classe désormais épuisée (…) Il est singulier que l’écriture/lecture de Borges connaisse un destin particulièrement favorable dans l’Europe capitaliste (17) »), ne pouvait pas être considérée comme une authentique nouveauté dans les lettres latino-américaines de l’époque. Si les positions politiques de Borges le rendaient assez dérangeant (18) (en particulier dans le Río de la Plata), sa condition de « maître » était pleinement reconnue par les nouveaux romanciers, de Cortázar à García Márquez. L’inclusion de Guillermo Cabrera Infante et l’armature théorique fournie par la nouvelle théorie littéraire française, l’affirmation selon laquelle l’assentiment était fatal pour le socialisme et la prétention que les auteurs traités étaient ceux qui allaient tuer le roman bourgeois, étaient certainement, en revanche, suffisamment provocateurs. Mais même si Fuentes discutait la catégorie de réalisme, il ne la remplaçait jamais par celle d’avant-garde.
Et s’il n’y avait pas eu strictement « une avant-garde », plusieurs œuvres qui avaient été pensées en termes d’innovation et de modernisation furent requalifiées comme « avant-gardistes » et on leur opposa, cette fois certainement, un programme esthétique de récupération de la représentation et de la communicabilité. Un concept plus traditionnel de la représentation incluait fortement les aspects de dénonciation et thématiques liés aux objectifs révolutionnaires de la littérature.
Depuis 1968, on peut enregistrer une sorte de polémique entre réalisme et avant-garde comme axe central des débats de la critique et des écrivains. L’existence de ce débat est paradoxale, puisque les œuvres littéraires latino-américaines n’étaient ni réalistes ni avant-gardistes dans le sens habituellement classique de ces notions.
La polémique était directement associée à la configuration du champ intellectuel latino-américain et aux nouveaux courants esthétiques qui commençaient à être hégémoniques à Cuba et qui s’apparentaient aux différentes façons de l’anti-avant-gardisme esthétique. Le problème, perspicacement détecté par Juan García Ponce, était que la « définition d’avant-garde n’acceptait pas de définitions (19) ». Et ainsi, comme il y eut un avant-gardisme historiciste et novateur au début de la période, il y en eut un autre qui attaquait l’expérimentalisme en termes idéologiques. Fondamentalement, cela concernait des écrivains tels que Carlos Fuentes, Vargas Llosa et Julio Cortázar, lesquels, dans leur tentative de politiser la parole, l’avaient définie comme un équivalent de subversion et de critique, ou des critiques qui, comme Ricardo Piglia, avaient affirmé que la littérature latino-américaine était une rébellion permanente contre les structures originaires de la langue et une nouvelle tentative pour conquérir la réalité par le langage (20). Ces positions se trouvaient, du coup, confrontées à de nouveaux fondements esthético-idéologiques qui discréditaient ce que ces romans avaient introduit dans l’art littéraire latino-américain. L’anti-avant-gardisme radicalement pro-révolutionnaire qui allait de pair avec l’anti-intellectualisme soulignait la tension entre l’efficacité communicative et l’efficacité esthétique de l’œuvre d’art.
L’anti-avant-gardisme du début insistait sur la nature anachronique de l’avant-garde et une certaine « misère des idées » de ceux qui utilisaient cette étiquette sans connaissance de cause. L’anti-avant-gardisme qui moulait l’état de la critique suivante et l’histoire intellectuelle était étroitement lié à une double critique : contre l’hermétisme d’un art pour quelques-uns, mais également contre le roman latino-américain, qui à l’époque avait été déclaré fondateur, authentiquement américain, qui avait été « ainsi » (d’après Cortázar et Retamar), et diffusé sous l’étiquette de nouveau réalisme. Bien ou mal théorisé par la critique et par les écrivains, il s’agissait d’un genre romanesque qui avait réussi à ce que le public s’adressât aux auteurs « en cherchant en eux l’expression ou l’ex- plication qui ne se trouve ni chez les politiciens ni chez les militaires (21) ».
Mais pas seulement le public, puisque le genre était également une pédagogie pour les nouveaux écrivains : Antonio Skármeta affirmait que le lien des Chiliens avec la littérature latino-américaine à l’époque fondatrice « jusqu’au succès de Cuba, la publication de La Ville et les Chiens précédée par le vacarme publicitaire de l’ingénieux prix Seix Barral, la « marellisation » de l’univers par la maison d’édition Sudamericana, était pratiquement nul », et, par conséquent, ils méprisaient la littérature latino-américaine qu’ils connaissaient jusqu’à présent. (22)
Cependant, dès qu’ils s’intégraient au circuit de la production et consommation marchande, ces romans étaient requalifiées d’« avant-gardistes », donnant lieu à un discours contestataire de l’avant-gardisme, qui questionnait, en outre, la stérilité du débat esthétique des temps préalables et les préjudices que cela avait occasionné à la constitution d’un programme esthétique vraiment révolutionnaire :
« À partir de 1966, une mal dirigée “ avant-garde ” ouvrit un faux dilemme et retarda le processus de consolidation d’un courant critique commencé trois ans avant une génération de jeunes auteurs et directeurs. La polémique réalisme/avant-garde détourna l’attention et confondait les valeurs esthétiques avec les idéologiques. Le réalisme devint synonyme de conservatisme, réaction et l’avant-garde l’expression du révolutionnaire, du nouveau. » (23)
La perception de la part des hommes de théâtre, genre que je n’ai pas abordé jusqu’à présent, est symptomatique, puisque de nouveaux genres et formes artistiques devaient prendre le relais du roman. Le théâtre, qui prescrit d’autres formes de réception, collectifs, pouvait nourrir des espoirs de politisation non rejetés par les avant-gardes poli- tiques. La quête d’un nouveau langage, considérée comme légitime et même indispensable, s’associait à l’excès d’imagination, l’individualisme de l’artiste et le vide idéologique ou, pire, avec le manque d’intérêt pour le social. Étant donné que l’anti-intellectualisme présentait ce qui était européen comme décadent (en reprenant un mot discrédité lors de longues et coûteuses polémiques), les esthétiques littéraires qui se servaient de concepts récemment inventés en France semblaient inopportunes pour certaines fractions de l’intelligentsia critique.
Le procès du boom signifiait une forte ré-hiérarchisation de la carte des genres, qui attaquait en particulier le roman et les romanciers, en opposant leur travail « gratuit » au sacrifice du peuple et des révolutionnaires :
« Tandis que García Márquez écrit Cent ans de solitude, en 1966, un prêtre colombien Camilo Torres, meurt en tant que guérillero dans les montagnes en faisant usage de la violence que l’écrivain met entre parenthèses ou ne veut pas peindre dans son livre. Comme si la génialité, la technique et la vision d’un Borges se greffaient aux tropiques et se vantaient d’être sous la protection d’un grand magicien, qui en plus se définit de gauche, pour assumer toutes les contradictions de l’intelligentsia colonisée, complice de l’angoisse et des disgrâces d’un peuple à la dérive. Le mystère ensorcelé de García Márquez a un nom : mythifier le présent. » (24)
La tension entre la tentative de démocratiser la culture et celle de la révolutionner était l’axe central autour duquel devrait tourner la discussion entre avant-garde et politique. Nombre d’écrivains durent se placer dans un équilibre précaire entre leur élitisme et leur sincère réformisme politique, se prononcer face au défi théorique qui supposait pour leurs affinités et positions politiques l’élargissement de la vie publique et la croissante participation des masses à celle-ci. L’écart entre la culture de masses et la culture des élites, qui était dans un processus d’approfondissement irréversible, constitue une donnée importante pour contextualiser les débats. La segmentation croissante entre les circuits de consommation et de production de culture rendait plus complexe et profonde la séparation entre les artistes et le public, tout particulièrement à l’horizon de la révolution, où on aspirait à la clôturer.
Notes :
13. En français dans le texte original. Allusion à Stendhal. (n.d.t)
14. Ambrosio fornet, « El intelectual en la revolución » [« L’intellectuel et la révolution »], dans Revolución, Letras, Arte [La Révolution, les Lettres et l’Art], La Havane, Letras Cubanas, 1980, 316-319.
15. Carlos fuentes, cit., p. 17
16. Ibidem, p. 30-31.
17. Roberto Fernández Retamar, « Calibán » [« Caliban »], dans AA., Revolución, Letras, Arte [La Revolución, les Arts et les Lettres], La Havane, Letras Cubanas, 1980, p. 255-256.
18. Les positions politiques fortement conservatrices de Borges ne faisaient pas mystère. En Argentine, il avait été un virulent anti-péroniste et avait soutenu les coups d’État militaires fascisants en Amérique latine, même si plus tard il changea d’avis par rapport aux desparecidos, par exemple.(n.d.t)
19. Voir Elena caso, cit.
20. Ricardo Piglia, « Prólogo » [« Préface »] a Las crónicas de Latinoamérica [Les chroniques de l’Amérique latine], Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1968, p. 8.
21. Antonio Skármeta, « Al fin y al cabo, es su propia vida la cosa más cercana que cada escritor tiene para echar mano » [« Après tout, c’est sa propre vie la chose la plus proche que caque écrivain a pour en mettre main »], dans Rama, Ángel (dir.), Más allá del boom : literatura y mercado [Au-delà du boom : littérature et marché], Buenos Aires, Folios, 1984, 267.
22. Julio Morandi, cit., p. 23.
23. Juan Carlos Martini real, « Gabriel García Márquez o las fabulaciones peligrosas » [« Gabriel García Márquez ou les affabulations dangeureses »], dans Latinoamericana, Buenos Aires, décembre 1972, 141.
24. Alberto Vanasco, « Acerca del denominado boom » [« Sur le dénommé boom »], dans Latinoamericana, Buenos Aires, numéro 1, décembre 1972, p. 6.
Traduit de l’espagnol par Luis Dapelo
Cet extrait a été reproduit avec l’aimable autorisation de l’éditeur Delga. Tous droits réservés.
Entre la plume et le fusil