Êtes-vous satisfaits du centenaire officiel de la Première Guerre mondiale ? Vous a-t-il servi à comprendre les vraies causes de la guerre, ainsi que les mécanismes de propagande massive qui ont conduit à cette boucherie ? En ce vingt-et-unième siècle où les tambours de guerre s’emballent, il est temps d’éclairer tous ces aspects. Pour comprendre la réalité cruelle de cette guerre. Mais aussi pour savoir comment a émergé, contre vents et marées, l’espoir dans un monde meilleur… L’historien Julien Papp, auteur de l’ouvrage « De l’Autriche-Hongrie en guerre à la République des Conseils (1914-1920) », décortique un chapitre de l’histoire « largement méconnu en France ». Entretien
Alex Anfruns : Dans votre livre, vous décrivez les mécanismes de propagande à l’œuvre aux prémices de 14-18, en mettant l’accent sur l’instrumentalisation du sentiment nationaliste hongrois. Quels sont les acteurs qui ont participé à cette propagande contre l’Entente ?
Julien Papp : Il faut d’abord noter qu’à l’échelon du pouvoir civil il n’existait pas en Hongrie un organisme central qui aurait organisé et coordonné les activités de propagande. Cette mission incombait au « Quartier militaire impérial et royal de la Presse » qui dépendait directement du chef d’état major. Il a été mis en place le jour même de la déclaration de guerre à la Serbie.
L’organisme a connu plusieurs remaniements qui allaient toujours dans le sens de l’élargissement de ses compétences. En 1917, il comprenait douze unités : commandement, censure, affaires intérieures et étrangères, propagande, presse, artistes, photographes, cinéma, section italienne, correspondants de guerre, appareil administratif. Le Quartier militaire de la Presse contrôlait les informations fournies par les journaux, il coordonnait les différentes activités de propagande et organisait la lutte contre la propagande ennemie.
Et du côté des civils ?
Dans l’arrière-pays, pour soutenir les efforts de guerre de la société, on a créé deux organisations : le Comité central de Secours de Budapest, et le Comité national de Secours militaire. Dans les deux cas, il s’agissait d’une coopération explicite entre l’État et les intellectuels proches du pouvoir. Finalement, quand on dit que la machinerie de la propagande guerrière ne reposait pas sur une institution étatique, cela ne doit pas cacher ou diminuer l’importance des instances politiques proches du pouvoir, même s’il n’apparaît pas toujours clairement si les initiatives étaient politiques ou spontanées. N’importe comment, le but était d’obtenir et de maintenir durablement le consentement de la population, une fois passée « la fièvre d’août », c’est-à-dire cette espèce d’hystérie collective qui a succédé à la déclaration de la guerre.
En dehors des cadres organisés, la propagande venue d’en-bas en quelque sorte, impliquait de nombreux acteurs : des journalistes avant tout, mais aussi des savants, des artistes, des écrivains, des poètes, des peintres… On pourrait y ajouter les services publics comme l’école et la Poste, ou encore les artisans qui fabriquaient d’innombrables objets en rapport avec la guerre. En peu de temps, c’est-à-dire en juillet août 1914, plus d’une douzaine de pièces de théâtre « patriotiques » ont vu le jour, dont certaines instrumentalisaient les souvenirs folklorisés de la guerre d’indépendance de 1848-49.

Vous dites que le rôle des journalistes a été important…
Oui. Leur action a été la plus massive, mais les intellectuels en général, et dans leur grande majorité, se sont lancés volontairement dans la justification de la guerre et la propagation de la politique belliqueuse du gouvernement. Comme dans les autres pays en guerre, il fallait proscrire toute critique et tout débat ; on ne jurait que par la nécessité de l’unité nationale et de l’acceptation des sacrifices. Chez les jeunes artistes mobilisés, l’attitude est souvent marquée par le reniement : ces gens se mettent à glorifier l’action et à dénigrer sinon haïr leur propre intellectualisme antérieur, comme le constate l’historienne hongroise Eszter Balàzs dont les travaux récents sur la propagande sont particulièrement suggestifs.
Cet auteur observe par ailleurs que ce sont les intellectuels belliqueux qui ont créé le mythe de l’enthousiasme massif et généralisé, en extrapolant à partir du climat qui régnait en août 1914 ; le but était de faire croire que la guerre émanait de la volonté générale. Les recherches récentes tendent à montrer que le bellicisme caractérisait surtout les classes moyennes, et qu’il existait des différences notables entre les villes et les campagnes et entre les différentes catégories sociales.
Les femmes aussi, motivées par la mode et la distinction, se sont signalées dans une proportion notable et au-delà des différences de classe, par un enthousiasme bruyant pour leurs « héros » de maris, de fils ou de frères, comme l’écrivait Andor Latzko dans une nouvelle puis dans un livre parus en 1917 et 1918 à Zurich. Le livre intitulé Hommes en guerre, fut aussitôt interdit en Hongrie, en Allemagne et en Autriche, puis en France, en Angleterre et aux États-Unis, après la traduction de l’ouvrage en français et en anglais. Louis Kassak, artiste et militant syndicaliste hongrois antimilitariste qui n’a pas retourné sa veste, écrira en 1934 que « jusqu’ici, la prétendue émancipation féminine n’a apporté que des déceptions à ses partisans, qu’il s’agisse des hommes et des femmes lucides ».
Quels moyens ont été mobilisés dans cette campagne de propagande en faveur de la guerre ?
Il y a là aussi comme un air de famille d’un pays à l’autre. Comme dans tous les États belligérants, les journaux constituent l’instrument principal de la propagande. En Hongrie, les grands quotidiens nationaux (Gazette de Budapest, Le Journal, Journal Hongrois, Gazette de Pest) et d’autres périodiques (Journal du Soir, Dernières Nouvelles, Petit Journal) tiraient entre 160 et 180 mille exemplaires. En 1872, on comptait seulement 65 journalistes professionnels et dix fois plus dans les années 1880.
Auteur d’une thèse sur les correspondants de guerre, Éva Gorda note que durant les années qui ont précédé le conflit, et même pendant la guerre, l’opinion publique hongroise considérait qu’on ne pouvait croire que ce qui était imprimé. Le cinéma et la radio existaient déjà, mais les gens étaient convaincus que seuls les journaux étaient crédibles. Cette remarque donne une bonne idée de l’impact de la presse.
Au début, le ton est à l’exaltation ; les mauvaises nouvelles sont passées sous silence, puis la censure entre en action et les colonnes vides apparaissent. On les remplit de réclames ou de résultats de courses de chevaux. En tout cas, ce moyen que constitue l’imprimé traverse pratiquement toutes les autres formes de propagande.

Ainsi, les journaux de la presse nationale reproduisent les textes des conférences organisées dans le cadre du Comité central de Secours. L’initiative de ces conférences venait d’ailleurs du propriétaire et rédacteur en chef de la Gazette de Budapest, Eugène Rákosi (aucun rapport avec le futur dictateur stalinien Mátyás Rákosi).
De façon significative, la série fut inaugurée par Ottokár Prohászka, un évêque antisémite et ennemi acharné du mouvement ouvrier révolutionnaire. La première séance eut lieu le 8 novembre 1914 dans un grand hôtel de luxe, devant une assistance de 300-400 personnes, issues de la « société cultivée » des classes moyennes et supérieures : uniquement des gens habitués des vernissages, des soirées et des réceptions, pour la plupart des belles dames et des belles jeunes filles.
Quels ont été les thèmes du discours de cette première conférence ?
L’évêque a présenté le conflit comme une épreuve spirituelle, avant de développer les avantages de la guerre et les inconvénients de la paix : celle-ci engendre une « culture molle et sentimentale », disait-il, alors que pendant la guerre le sacrifice agissant remplace les débats qui divisent la société .
Pour le saint homme, même le deuil, au lieu de rester égoïstement individualiste, doit conserver sa dignité devant l’image du héros. Celui-ci sera un des thèmes favoris des discours.
Les conférences successives parlent inlassablement et avec exaltation de l’héroïsme, de la « purification morale », de la virilité, du « miracle de l’enthousiasme », comme autant de qualités sublimes générées par la guerre ; il y en a qui font l’apologie de la poésie guerrière, affirmant que « la guerre est en elle-même une poésie » !
Édifiant ! Vous avez cité un autre organisme, le « Comité national de Secours militaire ». Quelles étaient ses activités ?
Le Comité national de Secours militaire était à la fois un organisme d’action sociale et un moyen de propagande. Son activité s’étendait sur l’ensemble du pays par le truchement des conférences organisées dans les villes principales ; et comme dans le cas précédent, les journaux apportaient leur contribution en publiant des annonces et des comptes-rendus.
La première séance eut lieu le 8 décembre 1914. L’orateur en était le ministre de la Défense en personne. « Dans son uniforme splendide orné de ses décorations », il parlait « avec un pathos noble et une conviction profonde » pour électriser son public : « des hommes d’État, des généraux, des femmes merveilleuses » comme l’écrivait le compte-rendu. Le ministre appelait à « l’auto-mobilisation », souhaitant que chaque citoyen devienne un soldat.
Les conférences suivantes se déroulaient aussi devant un public féminin pour la plupart. Pourtant, le dénigrement de la culture efféminée revenait souvent dans les discours, les orateurs ayant glorifié surtout la culture virile qui favorise l’action.
Cette vision du monde assez simpliste prétendait-elle convaincre le grand public ?
Un grand nombre d’universités, d’écoles supérieures et de lycées ont également mis en place leurs propres conférences guerrières. La Faculté des Sciences de Budapest les a organisées sur le modèle allemand et avec une fréquence hebdomadaire, dès la fin de 1914. Les séances étaient gratuites et accueillaient un vaste public. Pour convaincre les jeunes et la population en général, chaque professeur exposait la justification de la guerre du point de vue de sa discipline.
Parmi les thèmes sur le tapis, on rencontre le culte de la volonté, la condamnation de l’individualisme, la supériorité des puissances centrales, ou encore la nécessité de défendre la cause de la civilisation européenne que l’alliance perfide de l’Angleterre et de la France avec la Russie barbare avait laissé tomber.
A partir de 1916, quand les pertes humaines apparaissent dans toute leur énormité et que l’espoir de gagner la guerre s’éloigne, on peut parler d’une accentuation du rôle de l’État et du « Quartier militaire de la Presse » dans la propagande. Planifié dès 1909, cet organisme arrive alors à l’achèvement de son organisation.
Comme je disais avant, c’était une machine de propagande complète avec ses douze unités. Il comptait 400 personnes en 1914 et 800 à l’été 1918 ; le personnel comprenait des écrivains, des journalistes, des peintres et des dessinateurs, des sculpteurs, des photographes.
Quel était le message véhiculé par cette véritable équipe de choc issue de la « société civile » austro-hongroise ?
Les correspondants de guerre ne devaient parler que des succès, les articles qu’ils confectionnaient pour les journaux passaient d’abord par la censure. Quand ils étaient autorisés à visiter le front, c’était à l’occasion des succès et sans jamais avoir pu assister aux combats ; ils pouvaient voir les préparatifs et les terrains des affrontements quand ceux-ci avaient été nettoyés. Il leur fallait glorifier l’héroïsme des soldats, la compétence des officiers et l’organisation militaire dans son ensemble.
C’était pareil pour les artistes. Après avoir visité le front, ces derniers devaient à chaque fois présenter une série de peintures et de dessins, destinés à des expositions. Les artistes réalisaient aussi des cartes postales, des lithos de couleur, des marque-pages, des images miniatures, des diplômes, des médaillons, des plaquettes, etc. Avec les tableaux sélectionnés, une première exposition eut lieu le 6 janvier 1916 au Salon national de Budapest ; le public pouvait y voir 802 œuvres d’inspiration guerrière de 51 artistes. L’un d’entre eux dira qu’il fallait éviter la représentation des horreurs, les blessés gisant dans leur sang, l’amoncellement des cadavres, tous les sujets impropres à la glorification de la guerre.
Les photographes non plus ne pouvaient pas s’approcher des combats. Les innombrables photos se rapportent à la vie quotidienne des soldats et aux aspects matériels de leur existence. Une lettre reproduite en 1914 dans la revue des écrivains antimilitaristes Nyugat (Occident) disait : « Je suis entouré de toutes les horreurs de la guerre. Il est dommage que je ne sois pas libre de les décrire. Effroi, souffrance, privations, villages en flamme. »
Pourtant, à l’époque, les pacifistes disposaient aussi de leurs propres organes de presse… Leurs arguments et mots d’ordre n’étaient pas aussi efficaces?
Le parti social-démocrate représentait la principale force d’opposition à la guerre… tant que que la guerre n’a pas éclaté. Organisation politique et syndicale de masse, il exerçait, par son quotidien notamment, le Népszava (Voix du peuple), une influence large et profonde dans la classe ouvrière. Suivant les consignes de la IIe Internationale, il déploie une intense propagande pacifiste, surtout pendant le mois qui va de l’attentat de Sarajevo à la déclaration de la guerre.
Son journal explique que l’attentat est la conséquence de l’impérialisme austro-hongrois et de l’oppression nationale qui pèse sur les Serbes de la monarchie ; il envisage la grève générale en se réclamant de la solidarité internationale des ouvriers, et dénonce le « parlement de classe » où tous les partis ont voté pour la guerre. La dénonciation vise aussi la presse bourgeoise, acquise toute entière au bellicisme. Un éditorial apparaît tout à fait prémonitoire quand il prévient que la guerre pourrait entraîner des bouleversements sociaux et l’effondrement de la monarchie.
En dehors des sociaux-démocrates, et en dehors de l’Assemblée nationale, ce furent encore les bourgeois radicaux à se dresser avec détermination contre la guerre ; seuls les milieux féodaux et bancaires avaient intérêt à en découdre avec la Serbie, disaient-ils. Ils croyaient que, ensemble, les sociaux-démocrates et certains secteurs de la bourgeoisie pourraient empêcher la guerre impérialiste. Mais dès que le conflit a éclaté, ils se sont comportés comme l’appareil social-démocrate.
Toutes les voix humanistes se sont-elles éteintes par « réalisme »?
Il n’y avait guère que deux groupements intellectuels qui conserveront leur antimilitarisme actif. C’était d’une part les écrivains et les artistes groupés autour du militant syndicaliste et peintre avant-gardiste Louis Kassak, qui se démarquaient de l’ambiance belliqueuse.
Kassak publiait une revue intitulée L’Action puis, après l’interdiction de celle-ci, la revue Aujourd’hui. Son groupe, qui organisait notamment des conférences en faveur de la paix, a réagi vivement quand le parti social-démocrate a abandonné son pacifisme et épousé la cause belliciste.
Comment les belligérants ont-ils pu s’imposer face aux arguments et mots d’ordre des pacifistes ?
Le pouvoir a accrédité dès le début l’idée que les pacifistes se coupaient de la nation. Avec l’entrée en vigueur des mesures d’exception, le parti réformiste et son journal étaient menacés de disparition, alors que les dirigeants voulaient à tout prix sauver l’appareil. Mais au lieu de se taire, ils se sont mis à soutenir et à justifier la guerre impérialiste ; ils avançaient les arguments les plus absurdes, comme la défense de la démocratie ou la conquête de toutes sortes de droits ouvriers sur les champs de bataille.
Le deuxième groupement qui n’a pas transigé sur son antimilitarisme était le Cercle Galilée. Cette société de libre pensée et anticléricale poursuivait depuis sa fondation en 1908 une activité orientée vers l’acquisition et la diffusion des connaissances scientifiques. Quand la plupart de ses animateurs ont dû partir au front, une deuxième génération plus jeune a pris la relève ; l’équipe comprenait aussi plus de femmes qu’auparavant. D’emblée, le Cercle a mis au centre de ses travaux la portée économique et sociale de la guerre ; il organisait régulièrement des conférences sur la paix, en invitant les orateurs les plus en vue de la gauche, radicaux et sociaux-démocrates. Ce programme était souvent perturbé par les interdictions et les événements militaires.
L’antimilitarisme du Cercle reposait sur des idées marxistes, mais il puisait directement dans l’œuvre de Gustave Hervé, appelé apôtre de l’antimilitarisme par le poète Ady. Après son revirement spectaculaire, Hervé devint un repoussoir, et le porte-drapeau du combat contre la guerre sera Jean Jaurès.En 1915, les galiléistes commémorent avec ferveur le premier anniversaire de l’assassinat du leader socialiste français; c’était un moment important de leurs manifestations pour la paix.

Dès 1916, le Cercle lance des cours de russe, l’ancienne devise « Apprendre et enseigner » est remplacée par « Parlons nous aussi russe, agissons nous aussi russe ». À partir de 1917, les galiléistes participent régulièrement aux manifestations des syndicats contre la guerre ; de celle du 17 novembre 1917, ils ont été les principaux organisateurs. Puis, sous couvert de leurs séminaires et conférences, ils entreprennent de faire passer clandestinement des imprimés antimilitaristes sur les fronts ; ils font aussi réaliser des pseudo-examens médicaux attestant que des hommes appartenant à la gauche souffrent de la tuberculose, cela pour leur éviter leur départ au front.
En janvier 1918, des centaines de tracts furent dispersés et des affichettes collées sur les murs autour des casernes de Budapest. Pour l’essentiel, les textes appelaient à transformer la guerre mondiale en guerre civile. L’enquête policière aboutit à l’arrestation d’une trentaine de galiléistes, leur Cercle est fermé, les archives, la bibliothèque, la caisse sont confisquées. Au terme de huit mois de détention préventive, deux militants sont condamnés à deux et trois années d’emprisonnement. Ils seront bientôt libérés par la foule révolutionnaire du 30 octobre 1918.
Les réactions populaires contre la guerre ont-elles été importantes en Autriche-Hongrie ? A quelles difficultés se sont-elles heurtées?
Parler de réactions populaires serait un bien grand mot. Ce qu’on appelle de nos jours avec un peu de pédantisme l’élite politique et intellectuelle, donc ces gens tenaient le haut du pavé, et dans leur immense majorité ils flattaient les sentiments belliqueux, glorifiaient et justifiaient la guerre. Et à l’occasion du centenaire, tel que je peux en avoir connaissance, les paysans, les ouvriers et les autres catégories populaires n’apparaissent guère à travers les innombrables colloques. C’est par hasard que je tombe sur cette phrase de l’historien hongrois Andras Gerö : « l’opinion publique du pays est située plutôt du côté du parti de la paix ».
Concrètement, les réactions populaires se sont manifestées contre les conséquences de la guerre : les privations, les réquisitions, la militarisation des usines. Dans ce combat, elles étaient même soutenues par les appareils réformistes, ce qui ne manquait pas d’ambiguïté. La presse syndicale et social-démocrate était par exemple libre de dénoncer l’agiotage, la pénurie et, en général, la rapacité capitaliste, dans la mesure où cette propagande était dans l’intérêt d’une meilleure marche de la machine de guerre.
Mais cela ne devait pas aller trop loin. Dès que certaines grèves ou émeutes de la faim menaçaient la cause belliciste, la répression entrait en action de façon exemplaire, c’est-à-dire militaire. En cas de mouvements organisés, une pratique consistait à expédier les meneurs sur le front ; mais parfois les autorités hésitaient à recourir à cette méthode, craignant que l’absence des cadres ouvriers soit encore plus dangereuse.
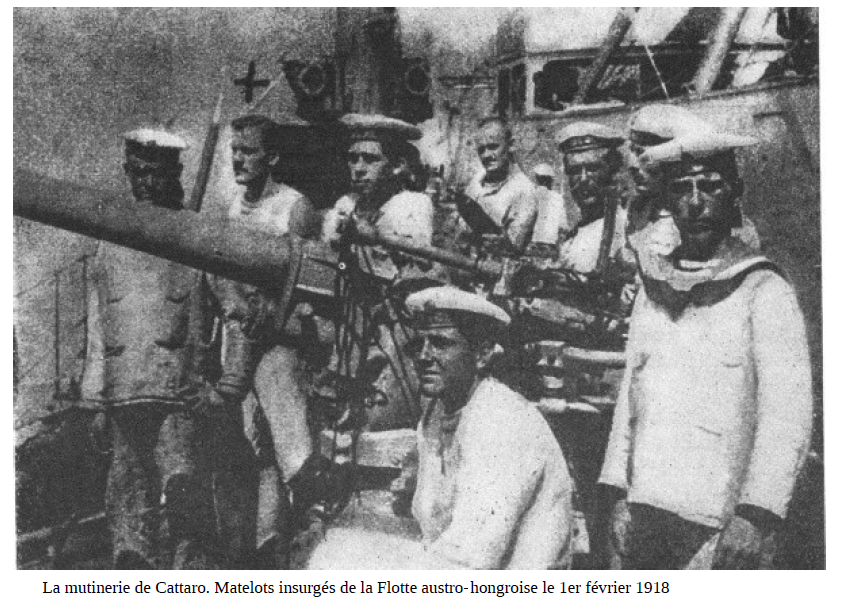

Quel a été l’impact de la Révolution d’Octobre, en particulier sur le phénomène des désertions dans le front, et de façon générale sur la reconstruction du mouvement contre la guerre ?
Les autorités militaires signalaient expressément les effets de la révolution bolchevique sur les désertions. Cet événement a entraîné en plus le retour massif des prisonniers de guerre après le traité de Brest-Litovsk, en mars 1918. Ils apportaient avec eux le souvenir des fraternisations et le sentiment que la guerre était terminée, alors que l’armée comptait sur ces contingents pour renforcer le front italien. A cette fin, elle a procédé par différentes méthodes comme les internements, les sélections ou la rééducation.
En fait, dès l’abdication de Nicolas II, les fraternisations ont pris une grande ampleur. Pendant les fêtes de Pâques, elles ont affecté tout le front oriental. Les mouvements spontanés furent ensuite encouragés par le pouvoir soviétique.
Le retour des anciens prisonniers de guerre austro-hongrois sera un levain puissant contre la poursuite de la guerre, et d’autant plus que la monarchie et ses armées sont à bout de souffle. Dans les mutineries qui sont nombreuses à cette époque, on rencontre systématiquement des meneurs et des porte-parole contaminés par les idées du bolchevisme, comme on disait alors.

Le 11 et le 13 novembre 1918, Charles IV renonce à ses titres d’Empereur de l’Autriche et de Roi de Hongrie. C’est le démembrement de l’Empire austro-hongrois. Mihaly Karolyi devient alors le premier président de la République populaire de Hongrie, mais la crise institutionnelle se poursuit. Quel est le contexte social à ce moment-là ?
La guerre a mis le pays dans une situation terrible. L’économie est désorganisée, une bonne partie de ses ressources minières et industrielles perdue avec les territoires enlevés ; la production s’effondre, le chômage et l’inflation frappent durement les classes populaires. Des régions de l’ancien royaume devenues « États successeurs » affluent des centaines de milliers de réfugiés vers la Hongrie réduite à un tiers de son ancienne superficie. Beaucoup sont issus des anciens appareils administratifs et policiers, qui fuient la vengeance des nationalités qu’ils n’avaient pas toujours traitées avec aménité, et c’est peu dire. Faute de logements, ils sont entassés dans des wagons ; un assez grand nombre d’entre eux iront garnir les équipes de la terreur blanche et les mouvements d’extrême-droite de l’entre-deux-guerres.
En février-mars 1919, la crise sociale pousse les travailleurs à l’action. Les occupations d’usines se multiplient, souvent les conseils ouvriers prennent en main leur direction. Le 17 mars, placé devant les faits accomplis, le gouvernement décide de créer un ministère chargé de la socialisation des entreprises industrielles. Le 18 mars, dans le grand centre industriel de Csepel, cinq mille ouvriers commémorent l’anniversaire de la Commune de Paris et prennent position pour la proclamation immédiate de la dictature prolétarienne ; le lendemain, vingt mille chômeurs défilent devant le ministère du Ravitaillement : menés par des militants communistes, ils demandent des secours et l’expropriation des moyens de production ; le 20 mars, c’est la grève générale des imprimeurs, qui prend rapidement un caractère politique.
Dans les campagnes, les paysans pauvres et les ouvriers agricoles procèdent, en Transdanubie notamment, au partage des grands domaines, on assiste aussi à des jugements populaires et à des scènes de pillage. En maints endroits, les habitants expulsent les administrateurs municipaux qui pendant la guerre s’occupaient des réquisitions et d’autres besognes impopulaires.
Pour réprimer ces actions, le gouvernement Karolyi a organisé des forces spéciales encadrées par des officiers de l’ancienne armée et appuyées sur les paysans riches. Dans les villages, se succèdent alors des raids punitifs et des exécutions sommaires. Cette vague de répression aurait fait plus de victimes parmi les paysans que tout ce qu’on avait connu sous la monarchie.
Le 20 mars arrive l’ultimatum de la conférence de Paris, qui provoque la démission de Karolyi. En quoi consistait cet ultimatum et quel a été son effet sur la république naissante ?
L’ultimatum en question, connu sous le nom de Note Vix, est une lettre remise à Karolyi par le lieutenant-colonel Fernand Vix, chef de la mission militaire de l’Entente à Budapest. C’est une injonction formulée par la conférence de paix de Paris le 26 février 1919, en vue de revendications territoriales. Les troupes hongroises encore présentes à l’est d’une ligne Arad-Nagyvarad-Szatmarnémeti (Arad-Oradea-Satu Mare) étaient sommées de se retirer à une centaine de kilomètres vers l’ouest, presque jusqu’à la rivière Tisza. Dans le territoire évacué, qui correspondait à toute la partie orientale de la Hongrie, les Alliés envisageaient la création d’une zone neutre large de 40 à 50 kilomètres, incluant notamment les villes de Debrecen, Szeged et Gyula ; plus à l’est, l’armée royale roumaine viendrait occuper le terrain.
Il se trouve qu’en février, cette armée n’a pas encore atteint les limites de la Transylvanie, à laquelle son gouvernement avait prétendu, conformément à l’accord secret conclu à Bucarest en août 1916 avec les Occidentaux. Pour appuyer son exigence, le Premier ministre Bratianu a exposé à Paris le danger du bolchevisme, menaçant à la fois du côté de la Hongrie, de l’Ukraine et de la Bessarabie. Il faut que les Alliés apportent leur soutien, disait-il, s’ils veulent que la Roumanie reste un bastion contre le bolchevisme.
L’idée de l’occupation roumaine et de la création d’une zone neutre était particulièrement bien accueillie par l’état-major français, et d’autant plus que le maréchal Foch venait de mettre au point son projet d’intervention contre la Russie soviétique ; et dans cette perspective, les armées polonaise et roumaine paraissaient les plus opérationnelles.

La naissance de la république communiste est donc directement liée à ce contexte. Karolyi ayant abdiqué, le nouveau régime assume, au milieu de mille difficultés, la guerre contre les armées tchèque et roumaines. Les travailleurs mobilisés dans une Armée rouge remportent des succès dans la reconquête de la Haute-Hongrie (la Slovaquie actuelle), alors que les Roumains restent bloqués par l’offensive de l’Armée rouge russe en Bessarabie.
La jonction entre les deux Armées rouges semble possible. Mais suite à deux sommations consécutives de Clemenceau, les troupes hongroises doivent arrêter leurs opérations pour se retirer sur les frontières redessinées par la conférence de la paix. En contre partie, le gouvernement des Conseils croit qu’il serait officiellement reconnu et que, conformément à la deuxième note Clemenceau, les Roumains évacueraient les territoires qu’ils occupaient à l’est de la Tisza. Ni l’une ni l’autre de ces promesses ne seront tenues.
L’abandon des territoires reconquis au prix de combats difficiles démoralise l’Armée rouge hongroise et, de leur côté, les troupes roumaines loin de se retirer, franchissent la Tisza, se livrent aux pillages, occupent Budapest et assurent l’avènement du régime contre-révolutionnaire de Horthy ; beaucoup de communistes seront internés dans des camps roumains, près de Bucarest.
Quelle fut alors la réaction des pays de l’Entente face à cette révolution pacifique ?
L’arrivée au pouvoir des communistes a provoqué une grosse surprise auprès des puissances de l’Entente. A la conférence de paix, il y a désormais une question hongroise. Le 6 avril, le général Franchet d’Esperey demande expressément à Clemenceau l’intervention militaire ; c’est qu’on redoute la propagation du bolchevisme.
En consultant la presse française de l’époque, je suis tombé sur un entrefilet de l’Est Républicain du 23 juillet 1919 qui reproduisait une interview que le général Pellé, chef de la mission militaire française à Prague, avait donnée à la Nouvelle Presse Libre de Vienne, et qui traduisait bien l’état d’esprit de la conférence de Paris.
« En ce qui concerne l’offensive contre Béla Kun, disait le général, la question hongroise n’est pas une question isolée, la Hongrie est un poste avancé de Lénine. À la volonté du bolchevisme l’Entente veut opposer une volonté unique et élaborer contre lui un front unique. Si l’Entente le veut, elle marchera parce qu’elle en a la force. Le temps des négociations a passé. Nous ne voulons pas la guerre, mais l’ordre et la paix au point de vue national et social. »

Par ailleurs, pour compléter ma réponse à votre question, je trouve intéressant de citer la réaction de l’Humanité, qui n’était pas encore communiste. Devant l’intervention contre la Hongrie des conseils, le journal écrivait en effet le 6 juillet 1919 :
« Il semble qu’on ait annoncé trop tôt la chute de Béla Kun. (…) Béla Kun sera évidemment forcé de céder devant la force car il n’a pas eu le temps, comme Trotsky, d’organiser une armée rouge capable de résister à l’invasion étrangère. Quelle que soit l’opinion que l’on ait sur le gouvernement des Soviets hongrois, le prolétariat français se souviendra que c’est un général français, agissant au nom de l’Entente, qui a étouffé la révolution hongroise, au moyen de mercenaires roumains et tchèques. Si le gouvernement de Béla Kun avait été renversé par les hongrois eux-mêmes, nous n’aurions rien à dire. Mais nous protestons ici le plus énergiquement contre cette politique brutale : l’intervention militaire dans les affaires intérieures d’un pays qui a le droit souverain de régler lui-même sa propre destinée. »
Ajoutons qu’en sa qualité de chef de la mission militaire, le général Pellé sera l’acteur principal de la création de l’armée tchécoslovaque, dont il devient le premier chef d’état-major. Il met en place des écoles militaires et des centres d’instruction pour le développement de cette armée. C’est lui qui conduira la contre-attaque pour bloquer l’avancée de l’Armée rouge hongroise en Haute-Hongrie.
Contrairement à la terrible situation que connut l’Allemagne, la social-démocratie hongroise et le parti communiste hongrois se fondèrent dans un seul et même parti, le Parti Socialiste de Hongrie. Comment décririez-vous leurs rapports à l’intérieur du parti ?
Au moment de l’unification, les sociaux-démocrates comptaient entre 700 et 800 000 adhérents, et les communistes environ 40 000 ; un livre anglais publié en 1967 indique 4000 à 7000 « militants » communistes. En tout cas, ces derniers étaient faiblement organisés, ils n’étaient pas vraiment enracinés dans les masses et ne possédaient pas la majorité dans les Conseils d’ouvriers, de soldats et de paysans.
La fusion a été conclue sans discussion dans le parti. Un rapporteur dira devant le Comité exécutif de l’Internationale communiste que la plupart des dirigeants y étaient hostiles. En particulier, les anciens prisonniers de guerre, appelés les « diplômés de la Révolution d’octobre », désapprouvaient la liquidation de leur organisation léniniste. Kun de son côté, a affirmé que les communistes étaient les seuls bénéficiaires de la fusion.
En fait, ces derniers se trouvaient noyés dans la masse du parti social-démocrate, qui, en plus, a beaucoup perdu de son caractère ouvrier depuis octobre 1918, en raison de l’arrivée dans le parti d’une foule d’éléments de la petite bourgeoisie. Par ailleurs, les meilleurs militants communistes ont été absorbés par l’Armée rouge, ce qui a contribué à l’affaiblissement de l’importance politique de leur parti.
Ce qu’il faut constater finalement, c’est que l’appareil réformiste pouvait toujours s’appuyer sur son implantation antérieure, sur les positions qu’il a conservées dans le parti, dans les syndicats, dans les mutuelles et associations diverses, alors que le parti communiste n’a pas eu le temps de mettre en place les relais indispensables dans la classe ouvrière. La sympathie des masses ne pouvait pas contrebalancer l’influence de l’ancienne direction réformiste, tout à fait en mesure de reconstituer son réseau de fonctionnaires, de délégués et autres responsables, tous favorables au maintien de l’ancienne bureaucratie de l’État.
Dans votre livre, vous citez le message que Lénine transmet à Béla Kun, le 23 mars 1919, où le leader de la révolution bolchevique met en garde Kun sur l’erreur qui serait commise au cas où la « tactique russe » était imitée. Quelle était la spécificité de la révolution hongroise et quelles vont être ses premières mesures ?
Le télégramme cité portait sur les rapports de force au sein du gouvernement, puisque la fusion entre les deux partis n’a pas annulé les couleurs des anciennes appartenances politiques. Le leader communiste Béla Kun, commissaire aux Affaires étrangères, était le véritable chef du Conseil de gouvernement, mais tous les autres postes de commissaires (équivalents des anciens ministres) appartenaient à des éléments du centre et de la gauche de l’ancien parti social-démocrate ; les vice-commissaires étaient en revanche, dans leur grande majorité, des communistes.
Tout cela, c’est-à-dire les rapports entre le parti né de la fusion, le pouvoir gouvernemental et la question du chef de l’État n’a pas pu être clarifié en raison des circonstances.
Quant à la spécificité de cette révolution du 21 mars 1919, elle a donné lieu à des appréciations diverses par la postérité. L’un des meilleurs connaisseurs de la période, l’historien hongrois Tibor Hajdu, ainsi que divers articles et déclarations venant des partis communistes occidentaux ont théorisé que le prolétariat pouvait conquérir le pouvoir par la voie pacifique ; plus proche de la réalité historique, l’auteur d’une thèse sur la question, Dominique Gros souligne qu’on ne pouvait pas isoler l’événement du 21 mars de ses conditions internes et de l’état de la révolution et de la contre-révolution internationales : plus concrètement, le prolétariat hongrois était armé, alors que la réaction ne possédait ni armée ni forces de répression efficaces.

Dès le 22 mars, le nouveau pouvoir a annoncé son programme : transformation de la Hongrie en République des conseils, socialisations des grandes propriétés, des mines, des grandes usines, des banques, des entreprises de transport ; la réforme agraire serait effectuée non pas par le partage des terres mais par la création de coopératives agricoles.
Le nouveau régime prendra des mesures d’une implacable sévérité contre les agioteurs et les spéculateurs qui profitent de la pénurie et de la misère des masses. Pour faire valoir la dictature du prolétariat et défendre le pays contre les envahisseurs tchèques et roumains, on annonce la création d’une grande armée prolétarienne.
Finalement, l’expérience de la République hongroise des Conseils ne durera que peu de temps, car l’Armée rouge dut capituler face à l’invasion de l’armée royale roumaine soutenue par l’Entente. S’ensuit la « terreur blanche » de Horthy, que certains mettent en parallèle avec la « terreur rouge ». Vous mettez en garde contre le « faux débat » des deux terreurs. Pourquoi ?
D’abord, m’engager dans les statistiques macabres laisserait supposer que je considère que tuer par exemple 150 personnes est moins grave que tuer 160…
Mais dans le contexte historique en question, ce qui fausse surtout la comparaison c’est que ce furent les classes dominantes qui ont, depuis des siècles, donné en exemple la violence comme moyen d’exercice du pouvoir. La mémoire populaire a conservé le souvenir du traitement dégradant des hommes sous le régime seigneurial, des féroces répressions des jacqueries et, plus récemment, de la violence policière que l’équipe de Tisza a exercée jusqu’au sein du Parlement. Les opprimés réagissaient à leur tour, spontanément, en s’inspirant en quelque sorte de ces précédents. Et la grande boucherie que la population venait de connaître était aussi l’affaire des « décideurs », comme on dit maintenant, et le carnage où ces messieurs ont entraîné les hommes a grandement contribué à dévaloriser la vie humaine.
Enfin, toujours à propos de cette mise en parallèle des deux terreurs, il a été souligné par des dirigeants du parti radical, qui étaient loin de sympathiser avec les communistes, que ces derniers étaient motivés par un programme et un idéal politiques, alors que les gens de Horthy se livraient à des actes de vengeance gratuits ponctués de tortures épouvantables ; leurs arguments aussi étaient mensongers car tout en se disant nationaux, ils se sont appuyés sur l’envahisseur roumain, et ils ont signé le traité qui a codifié le démembrement du pays.
Cette année clôt le cycle de commémorations du centenaire de la guerre 14-18. En tant qu’historien et spécialiste de cette période, quelles sont vos impressions sur la présentation qui en a été faite ?
En mai 2014, j’ai participé à un colloque de trois jours organisé par l’Université de Budapest. Cette expérience et la consultation de différents programmes en Hongrie (un Rendez-vous de l’Histoire à Blois a porté également sur la Grande Guerre, avec des conférences dans le style de « culture de guerre ») me donnent l’impression que, si je considère l’événement du point de vue des travaux historiques, on a eu affaire plus à une histoire militaire qu’à une histoire de la guerre, et plus à une histoire des élites et autres décideurs qu’à l’histoire de ceux qui avaient directement encaissé la catastrophe. J’entends par l’histoire de la guerre l’étude de l’événement dans toutes ses dimensions : militaire bien sûr, mais aussi politique, économique et surtout sociale.
C’est cette idée qui m’a poussé d’ailleurs à rédiger rapidement l’opuscule qui me vaut l’honneur de cet entretien avec vous. J’aurais voulu m’appuyer sur des recherches portant sur des questions comme les fraternisations, les désertions, le traitement et l’accueil des blessés, le sort des mutilés après le conflit, les rapports au sein des armées entre soldats et officiers, la « gestion » des morts, les pénuries, les réquisitions, les profits de guerre, les émeutes et les mutineries, l’accueil des propagandes dans le peuple, etc.
Du point de vue des travaux de recherche encore, ce que les meilleurs historiens universitaires français de la question appelaient dans les années 1980 la « cordiale connivence », c’est-à-dire l’action conjointe de la finance, des milieux d’affaires et de la diplomatie des puissances rivales, bref l’étude et la remise à jour de l’impérialisme n’a pas retenu l’attention des innombrables exposés. Je n’ai rencontré aucun travail qui aurait soulevé le rôle fondamental des banques et de l’exportation des capitaux dans la formation et la consolidation des systèmes supranationaux, qui ont fait que la guerre a été mondiale.
J’ai encore en tête quelques chiffres de mon intervention lors du colloque de Budapest. Entre 1888 et 1914 les prêts bancaires et investissements français en Russie sont passés de 1,46 milliards à plus de 12 milliards de francs ; et lors des dernières négociations en 1913, le gouvernement français a stipulé l’obligation pour le tsar la construction de nouvelles lignes ferroviaires à travers les territoires polonais, afin d’assurer le regroupement rapide et une plus grande mobilité des troupes russes. De son côté la Deutsche Bank avec ses grosses entreprises et ses concessions ferroviaires en Turquie, dont elle a équipé et modernisé les troupes, est devenue en elle-même un facteur de guerre mondiale, en menaçant directement les voies de communication de l’empire britannique.
D’autre part, si on admet ici et là l’importance cruciale de l’antagonisme germano-britannique, ce constat n’est pas traité à son échelle propre, c’est-à-dire qu’il n’apparaît pas comme le pivot par rapport aux nombreux problèmes régionaux ; il est noyé dans la multitude des facteurs belligènes, ou encore il apparaît comme collé sur les considérations interminables se rapportant aux questions balkaniques.
A cet égard, en France aussi, Les somnambules de Christopher Clark m’a semblé tout à fait significatif : la description par le menu de l’assassinat du couple Obrenovitch est un vrai roman policier, puis le lecteur se noie dans les innombrables détails de l’histoire diplomatique. Tel que j’en ai gardé le souvenir, ce n’est pas un bon livre, même si les éléments factuels sont toujours intéressants à connaître. S’il a été promu et flatté dans tous les sens, je pense que c’est en raison de son insistance sur la question serbe, un vieux truc des systèmes d’explication par le petit bout de la lorgnette, et parce qu’il a réussi à passer sous silence la place primordiale de l’Allemagne : une démarche que l’auteur adapte bien, délibérément ou inconsciemment, à l’idéologie politiquement correcte de l’européisme actuel.
Maintenant, en considérant le centenaire sous un angle mémoriel, j’aurais envie de poser ces genres de questions : pourquoi les auteurs qui, au-delà de la condamnation du stalinisme, ont contribué à criminaliser le communisme n’ont-ils pas éprouvé le besoin de globaliser et apporté leur talent pour criminaliser la guerre mondiale et ses généraux massacreurs ? pourquoi tous ces experts en cour n’ont-ils pas rédigé leur livre noir des régimes militarisés totalitaires de la guerre totale ?
Car on a bien inventé un truc comme la culture de guerre, que chacun peut comprendre à sa manière, mais qui, à mon sens, servira surtout à banaliser ou folkloriser la barbarie.
Quelles leçons devraient retenir les nouvelles générations sur 14-18 ?
J’espère que votre question ne me fera pas apparaître comme un donneur de leçon…
Comme j’ai été correspondant départemental du Comité d’histoire de la 2e Guerre mondiale et de l’IHTP (Institut d’histoire du temps présent) qui lui a succédé, c’est cette période que je connais de façon plus approfondie, au niveau des recherches et des débats qui traversent son historiographie.
Pour la 1ère Guerre mondiale, je conseillerais de lire d’abord les classiques du marxisme sur l’impérialisme ; le texte de Rosa Luxembourg par exemple sur La crise de la social-démocratie est lumineux. A l’Université (en France), le grand classique « libéral » est Pierre Renouvin pour l’histoire des relations internationales.
Les auteurs qui ont exposé des recherches empiriques et que j’ai « fréquentés » pendant mes études à la Sorbonne étaient des professeurs comme René Girault, Raymond Poidevin, Jean Bouvier, Jacques Thobie… Ils ont beaucoup travaillé sur les exportations des capitaux. J’ai été plus que surpris au Rendez-vous de l’Histoire de Blois consacré à la Grande guerre, où aucun exposé n’a évoqué ces travaux…
Plus récemment, j’ai consulté l’Anglais Alexander Anievas, qui s’occupe des concepts et théories marxistes concernant les origines de la guerre, il s’inspire surtout de L.Trotski, si j’ai bonne mémoire. J’ai consulté aussi La Grande Guerre des classes et suivi la conférence sur le net de Jacques Pauwels que vous connaissez bien.
À mon sens, nous vivons une époque profondément réactionnaire et obscurantiste. Pour ne pas se laisser submerger par les tapages médiatiques, par les niaiseries innombrables et les décervelages, les nouvelles générations doivent faire l’effort intellectuel contre l’amnésie : elles ont un devoir d’histoire pour étayer leur devoir de mémoire ; la mémoire du peuple et aussi de classe, avec ses peines, ses aspirations et ses combats, tels qu’on peut les connaître dans les bons livres d’histoire, dans les œuvres d’art et à travers les chants, qui sont, en France notamment, d’une extraordinaire richesse. Aucun ne devrait par exemple ignorer la Chanson de Craonne…
Quel regard portez-vous sur les bouleversements du monde contemporain ?
Je pense depuis un certain temps que les forces qui en 14-18 ont détruit l’Europe au nom des nations, détruisent aujourd’hui les nations au nom de l’Europe. Œuvre de l’Église catholique et des banques, cette Europe supranationale est en premier lieu une machine à détruire les services publics, qui sont, depuis la plus haute antiquité, consubstantiels avec la notion même de civilisation. La concurrence libre et non faussée est la guerre de tous contre tous, une forme de barbarie. La prétendue union a ressuscité la haine entre les peuples, en engendrant souvent les nationalismes de la plus triste mémoire en Europe.
Mais en remémorant cette inscription du Monument des maquis de l’Ain : « Où je meurs renaît la Patrie », je considère que les pacifistes et les internationalistes lucides ne devraient pas laisser la nation aux nationalistes et aux chauvins. On ne peut pas vraiment se mettre dans la peau d’une autre nation si on n’a pas intériorisé les meilleures traditions de la sienne.
Le cosmopolitisme aussi, si souvent évoqué, n’est finalement que la feuille de vigne du désordre capitaliste globalisé et féroce : le renard est devenu plus libre dans le poulailler plus libre. Et vouloir adapter l’ordre politique de son pays aux besoins du capitalisme globalisé est une naïveté sinon une monstruosité.
La libre circulation, les échanges scolaires et autres rencontres sont évidemment une bonne chose, mais les jeunes devraient aussi comprendre que la guerre ne relève pas des sentiments et des passions humains mais des institutions et des besoins économiques et sociaux de l’ordre, ou plutôt du désordre capitaliste.
Source : L’Autre Histoire
